« Y a-t-il du montage dans les films d’Éric Rohmer ? »
p. 237-244
Full text
1Après
Jacqueline Raynal, Cécile Decugis et Maria-Luisa Garcia, Mary Stephen
est la monteuse attitrée des huit longs métrages et des nombreux courts
métrages réalisés par Éric Rohmer depuis 1991 jusqu’à ce jour. Quand
elle n’est pas en tête-à-tête avec le cinéaste en salle de montage,
c’est derrière son piano qu’elle compose la musique du Conte d’hiver ou du Conte d’été, toujours en étroite collaboration avec lui.
Comment êtes-vous devenue monteuse des films d’Éric Rohmer ?
2Je connaissais
Éric bien avant de devenir la monteuse de ses films. J’étais étudiante
en cinéma à Montréal. Je suis venue à Paris dans le cadre d’un programme
de maîtrise, qui me permettait de suivre tous les cours de cinéma qui
m’intéressaient. Ce que je désirais avant tout, c’était réaliser des
films. Je ne savais pas que les études cinématographiques étaient à ce
moment-là (nous sommes en 1977) axées sur la sémiologie. C’était
beaucoup plus théorique que je ne le croyais. J’étais surprise, et je
n’étais pas seule dans ce cas ! Je n’ai trouvé qu’un seul cours qui
parlait de réalisation et de production d’un film, c’est-à-dire de
l’aspect concret du cinéma, le mercredi soir, à Paris-I : c’était celui
d’Éric Rohmer. La Marquise d’O… était sorti et Éric commençait à travailler sur Perceval le Gallois.
Il parlait de tout : non seulement de la forme d’un film, du cadre, du
montage, de la mise en scène, mais aussi du budget… Il avait une
approche pratique du cinéma qui m’intéressait beaucoup.
3Peu de temps
après, je me suis retirée du programme d’études américain et j’ai voulu
réaliser mon premier film en France. Il me fallait d’abord un budget. Je
me suis rendue aux Films du Losange pour demander une copie d’un
devis-type, à titre d’exemple. Barrage classique : la secrétaire a pris
mon numéro, en me disant que Rohmer était très occupé et qu’il ne
pouvait pas me recevoir. Je pensais bien que ça se passerait ainsi, mais
à peine rentrée chez moi, j’ai eu la surprise d’avoir Éric Rohmer au
téléphone ! Il m’a demandé de revenir immédiatement à son bureau pour
qu’il me donne ce dont j’avais besoin… De fil en aiguille, j’ai assisté à
la production de Perceval le Gallois. Éric avait déjà
l’habitude de répéter avec ses acteurs et actrices très longtemps avant
le début du tournage. J’étais dans mon coin, je ne gênais personne (je
parlais deux mots de français), et il était d’accord pour que j’observe
ce travail de répétition, avec Fabrice Luchini en particulier… C’était
très instructif.
4Ensuite j’ai continué à chercher de l’argent pour mon film, Ombres de soie,
que j’ai finalement pu réaliser en 1978. À cette même période, Éric a
fait appel à moi, sachant que je cherchais du travail, pour être
l’assistante de Cécile Decugis – qui avant de devenir sa monteuse
attitrée avait été celle d’A bout de souffle et de quelques
films de Truffaut. On m’a soufflé que Cécile n’était pas toujours tendre
avec ses assistantes… J’ai travaillé avec elle sur La Femme de l’aviateur :
elle a été charmante et presque maternelle avec moi. Elle est restée
une très bonne amie, et c’est une personne avec qui j’ai beaucoup
appris.
5Parallèlement, j’ai réalisé mon deuxième film en 16 mm (Justocœur)
avec une équipe très réduite, sur un mode plutôt amateur. Éric est venu
nous rendre visite pendant le tournage. Or il caressait déjà l’idée de
revenir aux sources de la Nouvelle Vague… Perceval le Gallois avait
été une grosse production, en studio, avec beaucoup de monde sur le
plateau. J’imagine que notre petit tournage coïncidait avec son désir de
travailler de façon légère et discrète… La Femme de l’aviateur en témoigne, qui fut tourné en 16 mm, avec une petite équipe.
Est-ce la Nouvelle Vague qui vous a influencée quant à cette façon de produire vos propres films ?
6C’est avant tout
le manque d’argent ! Mais il faudrait ici revenir plus en arrière : je
viens de Hong-Kong, et ma découverte du cinéma s’est faite avec la
Nouvelle Vague et certains films italiens. J’aimais beaucoup les films
de François Truffaut, d’Alain Resnais (Hiroshima mon Amour étant
mon film favori), et cela m’a peut-être décidée à venir en France… Une
fois à Paris, j’ai découvert les films de Marguerite Duras – auxquels
j’ai rendu hommage dans Ombres de soie. À ce propos, je sais qu’il est arrivé à Éric de projeter à ses étudiants India Song,
qu’il admirait en particulier pour des raisons économiques. C’était une
façon d’affirmer les possibilités qu’offre le cinéma jusque dans
l’absence de moyens. Le Rayon vert est très représentatif de ce souci du coût de production.
Vous n’avez pas travaillé sur Le Rayon vert…
7Non, j’avais
quitté Paris et le monde du cinéma pour vivre dans le sud de la France.
J’étais à Cannes, mais je restais en contact avec lui, et avec ses
proches. Pour un scénario qu’il me fallait traduire de l’anglais en
français, Rohmer m’a recommandé Françoise Etchegaray : c’est ainsi que
nous nous sommes rencontrées. Éric fréquente beaucoup de jeunes gens et
essaie toujours de leur trouver un travail, en les rapprochant les uns
des autres… D’une certaine façon, il nous a permis de subvenir
mutuellement à nos besoins. Il fait travailler ses amis et travaille
avec eux, en circuit fermé.
8Françoise
s’occupait donc avec moi de cette traduction, de même que je montais les
films que Rosette réalisait en super 8 (j’étais aussi chargée du son de
certains épisodes…). Nous sommes devenues très amies, et ce sont
d’excellents souvenirs : j’étais au son, Éric faisait le point, Virginie
Thévenet était également de la partie…
Quand avez-vous recommencé à travailler comme monteuse sur les films de Rohmer ?
9Je suis revenue à Paris au moment où il préparait Conte d’hiver,
en 1991. Pendant mon absence, Cécile Decugis avait pris sa retraite, et
c’est Maria-Luisa Garcia qui montait les films d’Éric. Elle faisait
partie du groupe, elle-même avait travaillé pour les courts métrages de
Rosette… Or à cette période-là, elle devait monter un film de
Jean-Claude Brisseau et ils avaient du retard. Luisa n’étant pas
disponible, Éric m’a proposé de travailler sur Conte d’hiver.
Je suis revenue à Paris au bon moment ! J’ai monté à la fois l’image et
le son du film. Et depuis, je n’ai pas cessé de travailler avec cette
petite famille.
Vous diriez donc qu’il existe un « esprit de famille » autour de Rohmer ?
10Oui, la CER est
comme une petite famille, composée d’Éric, de Françoise Etchegaray, de
Diane Baratier, de Pascal Ribier, de moi et quelques autres encore le
temps d’un tournage… Le premier film de l’équipe CER sous cette forme
était L’Arbre, le Maire et la Médiathèque. Éric ne voulait
aucun soutien de quelque organisme que ce soit, il voulait être
complètement indépendant. Tout était prêté (les lieux), et tout le monde
était en participation. Il avait aussi sa propre table de montage.
Seule la pellicule était à acheter. Il voulait faire un essai avec une
jeune débutante à l’image : ce fut Diane. Le film s’est fait alors que
nous étions tous employés à autre chose : dans mon cas, je venais
pendant ma pause déjeuner et après ma journée de travail au magazine Vogue pour monter un bout de film, et ainsi de suite.
Avez-vous parfois assisté au tournage d’un des films que vous avez montés ?
11Non. Au début de
notre collaboration, cela m’était même « interdit » ! Éric ne voulait
pas que je vienne sur les lieux de tournage. Si j’étais présente pour La Femme de l’aviateur,
ce n’était pas comme monteuse, mais comme figurante ! C’est simplement
pour une raison professionnelle : il est important que je garde un
regard neuf sur les scènes tournées ; je ne dois pas avoir le souvenir
des plans, des anecdotes du tournage ; cela fausserait mon regard…
Aujourd’hui encore, je préfère ne pas y assister.
12On en vient aux
spécificités du métier de monteur : c’est un métier de solitaire. On se
sent toujours un peu à l’écart – ce qui est d’autant plus frappant dans
mon cas qu’au sein de cette équipe, nous nous connaissons tous très
bien.
Êtes-vous seule pour monter les films ?
13Non, quand je dis
« solitaire », c’est pour dire : un peu en marge du reste de l’équipe
qui est au travail avant et pendant le tournage… Je monte toujours avec
Éric. Nous sommes tous les deux en salle de montage. Contrairement à
d’autres réalisateurs qui n’assistent pas au montage, il est présent
tous les jours avec moi. Je n’ai jamais eu d’assistante. Cécile Decugis
m’a eue comme assistante, j’aurais également pu en avoir une. Mais pour
lui comme pour moi, cela signifierait s’acclimater à une personne
nouvelle et travailler avec elle pendant plusieurs semaines… Il faut
savoir que le statut est différent aujourd’hui, puisqu’on monte en
virtuel : on ne forme plus quelqu’un sur le tas. Et le métier
d’assistant au montage est souvent très ingrat. Éric estime quant à lui
que le réalisateur a finalement peu de choses à faire en salle de
montage, donc qu’il peut rembobiner le film lui-même…
Il devient ainsi votre assistant au montage…
14En quelque sorte ! Sinon il s’ennuie. Il y a toujours de longs moments où il n’a rien à faire.
Vous travaillez à partir d’un découpage du film ?
15Éric travaille
avec un scénario, pas avec un découpage ; moi aussi. On utilise parfois
les rapports de la scripte – uniquement pour avoir une précision d’ordre
technique, en se référant aux commentaires de telle scène.
Mais il arrive souvent qu’il n’y ait pas de scripte au tournage…
16Dans ce cas il y a
toujours un rapport du laboratoire, au cas où il y aurait un problème à
l’image : si je vois une poussière sur l’écran, il faut savoir si c’est
lié au développement, ou (et c’est plus gênant) au tournage. On
bénéficie aussi d’un rapport sur le son. Mais c’est vraiment à partir
des rushes que tout se fait. Il n’y en a d’ailleurs pas
beaucoup, parce qu’il n’y a pas souvent plusieurs prises d’un même plan…
Ce n’est que quand je visionne les rushes pour la première
fois que je découvre enfin le film, même s’il m’est arrivé d’imaginer à
partir du scénario un découpage possible. Et Éric en profite pour
observer mes réactions ; si je ris, si à tel autre moment je suis émue,
etc.
Comment travaillez-vous actuellement au montage des Amours d’Astrée et de Céladon ?
17Tous les deux,
comme à notre habitude. Le film est inspiré de l’œuvre d’Honoré d’Urfé.
C’est l’histoire d’amour entre Astrée et Céladon qui est au centre de ce
roman pastoral de plusieurs tomes. D’Urfé développe beaucoup
d’histoires liées aux personnages secondaires du roman, pour en revenir
toujours à celle d’Astrée et Céladon… Je travaille, comme toujours, avec
le scénario en main, tout en visionnant les rushes. Le film a
été tourné en super 16 mais nous montons en virtuel – après avoir
longtemps monté en « traditionnel » (c’est-à-dire en pellicule).
Toutefois le rendu du 16, même « numérisé », n’est pas le même que celui
du 35. C’est plus frais, plus spontané, moins léché…
Y a-t-il pour vous une différence au montage entre les formats ?
18La façon de
travailler est la même ; la matière de la pellicule 16 mm est simplement
plus petite que celle de la 35 mm… Beaucoup des films que j’ai montés
ont été tournés en 16 mm, puis en vidéo. Éric s’intéresse aux
possibilités qu’offrent les nouvelles techniques : c’est notamment à
l’occasion des petits films produits par la CER qu’il a expérimenté la
vidéo gonflée en 35 mm par le procédé du kinescopage. Ce fut le cas pour
La Cambrure, juste avant L’Anglaise et le Duc.
19Pour L’Anglaise et le Duc,
il y avait beaucoup d’effets spéciaux (des incrustations) : Éric,
Françoise, Diane et moi avions tous rencontré l’infographiste. Le film
m’a demandé bien plus de travail que d’habitude – à cause des nombreux
petits plans, des petits personnages à incruster dans une fenêtre en
haut à droite de l’image par exemple… Nous montions un passage et il
fallait tout de suite œuvrer sur les effets spéciaux appropriés. Cela
s’est donc fait petit à petit, durant trois mois ; ce qui est peu par
rapport à d’autres productions équivalentes. Pour prendre un autre
exemple, Conte d’automne a été monté en huit semaines. Disons que la moyenne du temps de montage est de dix semaines.
Avez-vous monté tous les courts métrages produits par la CER ?
20Oui, je traite cette matière comme celle des autres films d’Éric. Excepté France,
le film de Diane, ils ont tous été montés par Éric et par moi. Ces
courts métrages montrent que l’équipe est un véritable atelier de
création, qui tourne facilement : d’abord parce qu’il n’y a pas une
machinerie lourde ; ensuite parce qu’il y a une vraie ardeur au travail.
Cet atelier permet-il de faire des émules ?
21Peut-être…
Peut-être davantage chez de jeunes cinéastes étrangers… J’en vois par
exemple en Chine, ou au Japon : ils adorent les films de Rohmer, ce sont
ses petits-enfants. Aux États-Unis, c’est également vrai. Sans oublier
l’attrait des nouveaux supports. Quand on pense à la DV aujourd’hui,
c’est un peu la Nouvelle Vague transposée – même si trop de facilité
n’est pas forcément une bonne chose, et n’offre pas toujours des
résultats convaincants.
Comment se déroule concrètement le montage, par exemple celui de Triple Agent ?
22Triple Agent est
un cas un peu particulier. Éric m’a d’abord demandé si je voulais
monter en virtuel ou en pellicule. Si nous avons le luxe de pouvoir
monter sur pellicule, avec une belle image, alors autant le faire !
C’était l’été 2003, dans une salle de montage sans climatisation, et
pour la séquence du début avec six personnages à table, nous avons
réellement souffert ! Souvent il tourne un grand bloc de dialogue sur un
personnage, même pendant que les autres parlent : c’était le cas pour
cette scène.
23En règle
générale, le travail de montage n’est jamais réellement admis comme tel
dans les films de Rohmer. Que ce soit à la Cinémathèque Française, lors
de la rétrospective de 2004, à la sortie de Triple Agent, ou à Venise pour L’Anglaise et le Duc…
des gens posent toujours la question : « Y a-t-il du montage dans les
films d’Éric Rohmer ? » Je sais rester calme, mais je suis prête à
demander à mon tour : « Y a-t-il de la lumière dans les films de
Rohmer ? » ou encore : « Y a-t-il des plans dans les films de
Rohmer ? »… Une telle question est ridicule ! Alors j’explique que le
simple ajout de trois images à la fin d’un plan change la dynamique qui
le relie à un autre, ainsi que son rythme et les nuances apportées à
l’histoire. Le cinéma de Rohmer est un cinéma tellement minimaliste que
le regard d’un personnage – en plus ou en moins – change beaucoup de
choses.
24Les spectateurs
qui pensent qu’il n’y a pas de montage dans les films de Rohmer sont
ceux qui croient que tout est déjà prévu et écrit. C’est faux : le
scénario est écrit, mais il n’y a pas un découpage préétabli. Au
montage, on a un plan sur Marie Rivière, un autre sur Béatrice Romand…
et le film s’écrit aussi à ce moment précis. Mon travail consiste en
cela : une fois qu’on a mis les rushes en ordre, on dispose de
deux écrans, grâce auxquels on déroule deux images. C’est parfait pour
le champ/contre-champ, les deux images permettent de choisir à quel
moment raccorder un plan à un autre. On a aussi une grande bobine de
chutes… En général, quand on monte un film en pellicule, on dispose des
bouts de film dans un chutier, et chaque bout est étiqueté. Un autre
système veut qu’on utilise plusieurs rouleaux. Avec Éric, on adopte le
système suivant : on monte le film dans son ordre chronologique et tout
plan dont on ne veut pas est enroulé sur une autre bobine. On finit par
avoir une bobine qui est le montage du film et une bobine faite des
chutes, classées elles aussi dans leur ordre chronologique… Dans le cas
fréquent où un film est monté en plusieurs fois, cela autorise bien sûr
des modifications mais oblige à rechercher une chute dans un grand
désordre ; dans notre cas, si nous avons besoin d’un plan que nous
n’avions pas conservé pour la version finale, nous le retrouvons
facilement dans cette bobine de bout-à-bout en ordre. Nous n’avons tout
simplement pas besoin de chutier.
Dans le cas d’un champ/contre-champ, tombez-vous toujours d’accord sur les coupes à opérer – en gardant par exemple le personnage silencieux qui écoute l’autre ?
25J’adore cela !
Éric aussi. À ce propos, on a des moments d’hésitation : va-t-on montrer
la personne qui parle, alors que l’autre est très intéressante dans son
attitude d’écoute ? On en discute – mais souvent c’est instinctif, et
pour lui et pour moi ; souvent on réagit au même moment sur le plan à
garder, et sur sa durée.
Arrive-t-il que des scènes ne soient pas au montage ?
26C’est plutôt rare. Je me souviens qu’on a coupé deux grands passages de dialogues dans une même scène pour Conte d’été. Pour Triple Agent, deux séquences ne sont pas dans le film. Mais pour Les Rendez-Vous de Paris par exemple, aucune scène n’a été supprimée. Toute la matière est utilisée et se retrouve dans le film.
27L’Anglaise et le Duc,
après un premier montage, durait deux heures vingt. C’était trop long.
Pathé voulait revenir à moins de deux heures. Nous avons cherché où nous
pouvions couper. J’ai beaucoup resserré certaines scènes pour qu’elles
soient plus rapides… On peut toujours raccourcir un film, mais il vient
un moment où ce n’est plus possible : soit on change la structure, soit
le récit devient bancal… Il faut maintenir en permanence une harmonie
dans le récit. Et on peut trouver cette harmonie sous différentes
formes : dans Conte d’été par exemple, les dix premières
minutes sans dialogue étaient nécessaires. Éric voulait à juste titre
cette longue déambulation de Gaspard dans Dinard, pour que le spectateur
éprouve sa solitude.
J’ai lu qu’Éric Rohmer avait déjà remonté au moins un de ses films (Conte de Printemps), pour sa diffusion à la télévision. A-t-il effectué des changements pour les sorties en DVD ?
28Non. Pour Triple Agent,
nous avions coupé une scène qu’Éric envisageait de réinsérer lors de la
sortie en DVD, mais nous avons finalement abandonné cette idée. Le film
était bien ainsi… Quant aux suppléments, on les a aménagés en fonction
des interviews que Rohmer voulait conserver. Il ne voulait pas que les
images « abîment » ce qui était dit du film, donc nous avons parfois
laissé un poste de radio à l’image pendant tout l’entretien ! Éric ne
voit pas quel usage on peut tirer d’un bonus. S’il a décidé d’en mettre, il tenait beaucoup à s’en occuper lui-même.
Comment procédez-vous pour le mixage son ?
29Depuis qu’Éric
travaille avec Pascal Ribier, le montage-son se fait après le
montage-image. Pascal prépare toujours un pré-mixage chez lui, Rohmer se
joint de temps en temps à lui pour voir les avancées… Puis nous faisons
un mixage définitif ensemble, en auditorium. Nous avons commencé à
mixer en stéréo avec L’Anglaise et le Duc.
30Pour Les Amours d’Astrée et de Céladon,
il y a actuellement un travail à faire avec l’aide de l’IRCAM sur la
voix d’un personnage, au moment où il se déguise en fille. L’idée est de
garder la voix réelle de l’acteur, mais en la modifiant pour la rendre
féminine (procédé déjà utilisé dans Tirésia de Bertrand
Bonello). Cette métamorphose vocale ne concerne qu’une séquence, mais
demande beaucoup de travail. Il fallait donc la monter avant les autres.
Pour le reste, c’est encore et toujours dans l’ordre chronologique du
film que nous montons.
Quel film avez-vous particulièrement aimé monter ?
31Tous, bien sûr ! Mais Conte d’automne est
peut-être mon favori. Nous avons beaucoup travaillé le
champ/contre-champ… Alain Libolt est formidable à l’écoute, Marie
Rivière est somptueuse, avec de petites expressions, des yeux… J’aime
particulièrement Conte d’automne aussi pour sa dernière
séquence, celle du mariage. Nous aurions pu monter quelque chose de très
joli et en même temps d’assez anodin, avec cette petite danse… Mais je
suis tombée sur ce moment ou Marie lève la tête, son visage est comme
assombri par un remords, ou par des regrets – on ne sait pas. Le film
devait finir sur ce plan, qui apporte une réelle nuance à l’histoire.
Parlons de la musique : vous êtes « une moitié » de Sébastien Erms, le compositeur, avec Jean-Louis Valero, des films d’Éric Rohmer… « E » et « R » pour Éric Rohmer, et « M » et « S » pour Mary Stephen ?
32Oui, cela a commencé comme une blague ! J’avais déjà travaillé sur la musique pour la fin de La Femme de l’aviateur :
Éric avait eu l’idée d’une chanson à partir d’un texte qu’il avait
écrit et d’une mélodie qu’il avait en tête ; je l’ai mise en musique,
avec un accompagnement au piano. Ensuite Jean-Louis Valero a réarrangé
la chanson, avec un son d’orgue… Quand j’ai quitté Paris, Éric a
beaucoup travaillé avec Valero, qui est un excellent compositeur. Plus
tard, alors que je montais Conte d’hiver, Éric m’a dit : « J’ai
un petit air en tête, que je vais peut-être donner à Valero pour qu’il
le travaille. » Mais il était gêné de ne lui présenter que ces deux
petites lignes… Je lui ai proposé de développer le thème. Il voulait une
fugue : j’ai quand même concocté, à partir de sa mélodie, un morceau
qui lui a plu et que nous avons utilisé dans le prologue. J’ai pensé en
outre qu’on pourrait retrouver un écho de ce thème (celui de l’amour
perdu de Félicie, l’héroïne), plus loin dans le film. Finalement on
l’entend lors de la représentation théâtrale… Pour cette deuxième
collaboration, nous avons décidé de prendre un pseudonyme : « Erms »,
avec nos initiales, et « Sébastien », en hommage à Bach.
Et pour Conte d’été ?
33Éric avait quatre
lignes, et toujours des paroles. J’ai travaillé au piano, et Melvil
Poupaud a retranscrit le thème à la guitare. Son personnage de Gaspard
compose le morceau tout au long du film – simplement à la voix et à la
guitare. De sorte que lors du dîner après la sortie en bateau,
l’accordéoniste se plaint avec raison d’un excès de « bémols ». Il
apparaît clairement que ce thème n’est pas écrit pour l’accordéon !
C’est quelque chose à quoi je n’avais pas pensé quand j’ai composé le
morceau au piano…
34Éric n’aime pas la musique de film, et n’utilise jamais de musique d’accompagnement.
35La seule fois où il a fait exception à cette règle, c’est pour Le Rayon vert – et Valero a écrit une partition superbe.
Pour revenir aux Amours d’Astrée et de Céladon, est-ce un film qui se rapproche d’autres films d’Éric Rohmer comme les adaptations d’œuvres littéraires ou les films historiques ?
36Non, chaque film est différent. Même si c’est en costumes, cela ne ressemble pas à L’Anglaise et le Duc :
d’un côté, on a un film historique, de l’autre une pure fiction – et
plus précisément une histoire d’amour… Peut-être faut-il plutôt chercher
une ressemblance avec les « Contes »… Mais qu’il soit en costumes ou en
décors naturels ne suffit pas à rapprocher ce film d’un autre. J’ai
revu récemment La Marquise d’O… : c’est encore très différent. Les Amours d’Astrée et de Céladon est
un roman pastoral, tout le cadre est bucolique et les personnages sont
en symbiose avec la nature. C’est presque à l’opposé de Perceval le Gallois, qui était complètement tourné en studio.
Qu’en est-il du rythme et de l’image ?
37En ce qui concerne le rythme, Triple Agent pouvait sembler plus « étendu » que L’Anglaise et le Duc : je pense que c’est dû aux nombreux blocs de monologues du personnage interprété par Serge Renko. Dans Les Amours d’Astrée et de Céladon,
on est en pleine nature, l’histoire est toujours relancée, entraînée
vers l’avant ; j’ai l’impression que le film est plus rythmé que le
précédent… Mais j’ai toujours cette impression au montage : c’est un peu
tôt pour le dire.
38En termes de beauté de l’image, peut-être se rapproche-t-on de L’Arbre, le Maire et la Médiathèque… Certaines séquences bénéficient des éléments de la nature, du vent et d’une lumière extraordinaire !
La parole, les dialogues jouent-ils un rôle prépondérant ?
39Éric est resté fidèle aux dialogues du livre – mais si dans le huis clos de Triple Agent, la parole était primordiale, ce n’est pas le cas ici, principalement parce que le cadre naturel a vraiment son importance.
40On pourrait
imaginer que ce travail est atypique pour Éric Rohmer : à mon avis, il
s’inscrit totalement dans la lignée de son œuvre – tant dans la forme
que dans les thèmes qu’il affectionne… Éric est très content des images
qu’on a montées jusqu’à aujourd’hui. Comme je l’ai dit, c’est toujours
au montage que les choses prennent leur place, particulièrement pour
ceux qui travaillent avec lui. On a constamment l’impression qu’il a eu
dès le début une idée claire du film, qu’il l’a déjà joué dans sa tête…
Et on ne découvre sa vision des choses qu’une fois le film monté : c’est
toujours une surprise. Une très bonne surprise.
41Propos recueillis par
Philippe Fauvel, en mai et octobre 2006.
Philippe Fauvel, en mai et octobre 2006.
http://www.chinesemovies.com.fr/Musique_photo_montage_Mary_Stephen.htm
|
Musique,
photo, montage
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
..
depuis quand un livre est-il donc autre chose
Que le rêve d'un jour qu'on raconte un instant ; Un oiseau qui gazouille et s'envole ; ….
Un ami
qu'on aborde, avec lequel on cause,
Moitié lui répondant, et moitié l'écoutant ?
Alfred de Musset, Namouna
Telle qu’en
elle-même : Mary Stephen
par Brigitte
Duzan, 6 mai 2013
derrière cette
façade si bien polie qu’elle en devient classique. Classique
au prix de la subversion du baroque, dans son sens le plus
apollinien : du baroque comme esthétique de
vie, de vie
transformée en art, avec tout ce que cela comporte de
flamboyance, mais de doute, aussi.
L’histoire simple
ne l’est pas restée longtemps…
1. Pour commencer –
la monteuse que l’on sait, et que l’on sait moins
Chaque
instant tombe à chaque instant dans l’imaginaire, et à peine
l’on est mort, l’on s’en va rejoindre, avec la vitesse de la
lumière, les centaures et les anges… Que dis-je ! A peine le
dos tourné, à peine sortis de la vue, l’opinion fait de nous
ce qu’elle peut !
Paul Valéry, Petite lettre sur les mythes
Au détour du
chemin…
Un beau jour de
1977, une jeune étudiante d’origine chinoise fraîchement
débarquée à Paris, déçue par les cours de cinéma très
ésotériques qu’on lui dispensait, est allée s’inscrire au
cours hebdomadaire de cinéma que donnait, le mercredi soir,
à l'Institut d'art et d'archéologie, rue Michelet, un Eric
Rohmer au sommet de sa carrière qui était le seul à aborder
le sujet sous son aspect concret.
C’était un ascète
agrégé, amoureux du verbe, qui, après la « La marquise
d’O », Grand Prix du jury à Cannes, était en train de
préparer le film le plus fou et le plus génial de sa
carrière, « Perceval le Gallois », pour lequel il venait de
passer deux ans à traduire d’occitan en français les neuf
mille deux cent trente quatre vers laissés à sa mort par
Chrétien de Troyes.
Eric Rohmer
symbolisait la Nouvelle Vague, dans son côté le plus
exigeant. Il enseignait l’aspect pratique du cinéma, parlait
de mise en scène, de narration, de cadre, de montage, mais
aussi de ce qu’on néglige souvent : le respect d’un budget,
la rigueur et l’économie de moyens, et l’adaptation de ces
principes à la réalisation d’un projet artistique.
Or, Mary avait un
projet, justement, elle voulait faire un film. Elle n’écouta
que son courage, ou plutôt surmonta la timidité devenue
panique qui lui coupait les jambes – « la volonté
d’arriver suffit à tout », dit Camus dans « Le mythe de
Sisyphe » - et s’en alla frapper à la porte de la secrétaire
pour demander… un budget-type. On imagine la réponse :
monsieur Rohmer est très occupé, je vais transmettre. Ce
qu’elle fit, mais avec une petite note en marge : adorable
minois…
Adorable et
exotique, Mary l’était, et il n’y en avait pas beaucoup dans
la classe, le seul autre asiatique étant Dai Sijie,
qui ne répondait pas vraiment à la même description. Rohmer
rappela, pour dire qu’elle pouvait venir chercher le papier
demandé ; il était là, et passa désormais du rang de
cinéaste modèle et transcendant au rôle de mentor amical et
attentif. Le maître avait trouvé une disciple avec laquelle
communier dans le même amour du cinéma, de Paris et du thé.
Premières armes
se
souvenait,/ celui qui chevalier le fit/ qui lui enseigna et
apprit que de trop parler se gardât…. ». Luchini avait
commencé chez Rohmer, dans « Le genou de Claire », Perceval
allait être son grand rôle, celui qui lui vaudrait trois ans
et demi de chômage, comme il le dit dans ses moments
d’humour. C’étaient de grands moments de théâtre.
son
équipe à réaliser leurs propres films. Pour le premier de
ces courts métrages, « Rosette sort le soir », sorti en
1983, Rohmer lui-même apparaît dans le rôle du père ; quant
au rôle principal du troisième, « Rosette vend des roses »,
il est tenu par Virginie Thévenet, l’actrice qui interprète
le rôle de Camille dans « Les nuits de la pleine lune ».
Mary travailla sur le montage de ces films, mais eut aussi
la charge du son pour certaines séquences.
Intermède
réintégra l’équipe aussitôt. C’était en 1991, au moment où
Rohmer était en train de préparer « Le conte d’hiver ». Elle
arrivait à point.
D’assistante
monteuse à monteuse
Quand elle arriva,
en effet, Cécile Decugis avait pris sa retraite et avait été
remplacée par María-Luisa García, qui avait, elle aussi,
travaillé sur les courts métrages de Rosette et était
devenue l’assistante de Cécile après le départ de Mary. Or,
à ce moment-là, elle était occupée sur le tournage d’un film
de Jean-Claude Brisseau, « Céline », dans lequel elle jouait
également. Ne voulant pas attendre, Rohmer confia donc à
Mary le montage du « Conte d’hiver », et à la fois de
l’image et du son.
Et la musique,
aussi
Ce que l’on sait
moins, c’est que Mary a même contribué à la musique de
nombreux films, le pseudonyme Sébastien Erms figurant aux
génériques signifiant Eric Rohmer/Mary Stephen et Sébastien
étant un hommage à Bach.
Tout a commencé,
dit-elle, avec « La femme de l’aviateur » ; pour ce film,
Rohmer avait eu l’idée d’une chanson sur un texte qu’il
avait écrit, avec une mélodie de son invention ; Mary a
écrit la musique au piano. C’est ensuite Jean-Louis Valero
qui a fait l’arrangement, avec un accompagnement à l’orgue
électrique – pauvre Valero qui deviendra le compositeur de
la musique des films d’un Rohmer qui détestait la musique de
film et considérait ses films ratés s’ils en avaient besoin…
La chanson à la fin
de La femme de l’aviateur (2.08)
Le pseudonyme a
ensuite été inventé en 1991 pour « Le conte d’hiver » où le
même genre de collaboration a été repris : un petit air
imaginé par Rohmer, développé par Mary, et utilisé en
prologue ; sorte de thème de l’amour perdu qui parcourt le
film : quelques petites notes égrenées au piano, avec une
variation à la flûte …
Le thème du Conte
d’hiver
Dans « Le conte
d’été », la chanson est même intégrée dans le film, dans une
séquence où Gwenaële Simon l’apprend, accompagnée à la
guitare par Melvil Poupaud – le thème étant ensuite repris
accompagné à l’accordéon.
La flibustière,
chanson du Conte d’été
Finalement,
cependant, le destin ramena soudain Mary vers la Chine,
comme une vague de fond qui ramène sur le rivage un corps
qu’elle a entraîné au large.
De Rohmer à la
Chine
qu’elle s’abstient d’assister aux tournages pour se
préserver un regard distancié.
Cette méthode de
travail vit sa première concrétisation avec
« Nuit de Chine » (《中国之夜》),
de
Ju Anqi (雎安奇),
dans sa version pour Arte, entièrement remontée par Mary et
produite par Blanche Guichou d’Agat Films. Ju Anqi n’a
jamais mis les pieds dans la salle de montage, mais le
résultat a validé la méthode : le film fut primé au Festival
Visions du Réel à Nyons en 2008.
Le destin se
manifesta peu après pour signifier symboliquement le passage
de relais. Mary fut invitée par
Isabelle Glachant,
avec Françoise Etchegaray, directrice de la Compagnie Eric
Rohmer, à la projection à Pékin de « L’Anglaise et le Duc ».
C’était leur première rencontre. Isabelle mit Mary en
relation avec Li Yang (李杨) ;
après « Blind Shaft » (《神木》) en 2003, abandonnant le monde de la mine pour celui de la condition de
la femme dans les coins perdus de la Chine dite moderne, il
était en train de terminer « Blind Mountain » (《盲山》)
et allait avoir besoin d’elle.
réalisateur et la première amorce
d’une profonde amitié entre Mary et lui. Son montage est
basé sur une alternance de portraits contrastés qui
dessinent celui d’une société en mutation, entre la campagne
et la ville.
L’année suivante,
Du Haibin lui confia à nouveau le montage de
1428 (《1428》),
son documentaire sur le tremblement de terre du Sichuan qui
est unanimement considéré comme une véritable réussite. Il
est aussi un parfait exemple de la magie qu’opère un montage
imaginatif, et réalisé, ici, en parfaite symbiose avec le
réalisateur. Du Haibin a d’abord eu l’idée originale
d’utiliser comme image symbolique la figure du vagabond en
errance au milieu des ruines et des abris de fortune, tel un
témoin amnésique en quête de sa mémoire et de son passé ;
Mary a ensuite fait de sa silhouette récurrente la trame de
la structure narrative du documentaire et ce qui lui donne
son rythme.
Le double événement
– le succès de « 1428 » et la mort de Rohmer – a marqué un
tournant dans une carrière tournée dorénavant de plus en
plus vers la Chine, entre Paris, Pékin et Hong Kong, et, au
cours des dernières années, au service, surtout, de toutes
jeunes réalisatrices, comme
Yang
Lina (杨荔钠)
ou Jessey Tsang (曾翠珊),
l’une de Chine continentale, l’autre de Hong Kong.
Isabelle Glachant
qui a, là aussi, introduit Mary auprès de la réalisatrice.
Et de la Chine à la
Turquie
l’envahisseur
pour communiquer entre eux : un sabir anglais qui prend
parfois des allures de poème épique.
C’est un film d’un
souffle, d’un lyrisme exceptionnels, mais qui les a acquis
au montage. Les faiblesses inhérentes au départ ont été
gommées, en restructurant le scénario, et en insufflant au
film le rythme et l’élan poétique qui lui donnent toute sa
force émotionnelle.
perpétuant ainsi les structures paternalistes de la
société turque dont il a pourtant souffert dans sa jeunesse.
« Majority » a
obtenu le Lion du Futur à la Biennale de Venise en 2010,
avant de connaître un parcours triomphal dans le circuit des
festivals, en Turquie même et ailleurs. Pour son second
film, « Silence », encore en préparation, Mary a ensuite mis
Seren Yüce en contact avec le jeune producteur français
Thomas Ordonneau, de la société de production/diffusion
Shellac. Il lui reste encore à le monter…
Elle est
aujourd’hui considérée, par les intéressés, comme la
marraine de ce nouveau cinéma turc où elle retrouve, selon
ses propres dires, une pureté, une passion, un élan et un
engagement politique qui sont parmi les valeurs auxquelles
elle attache le plus de prix ; c’est d’ailleurs pour les
mêmes raisons qu’elle a monté le film omnibus « Do not
Forget Me, Istanbul », réalisé par sept cinéastes du
pourtour méditerranéen.
Ce cinéma forme
maintenant, après le cinéma chinois, son second principal
centre d’intérêt et de travail. Travail qui la fait vivre en
transit perpétuel, entre deux avions, sa valise à la main.
S’arrêtant de temps à autre, fatiguée, en songeant aux
peines subies avant d’en arriver là, en un flash-back qui
est l’un de ses modes privilégiés d’écriture, sinon de
montage.
2. Flash-back – ce
que l’on ne sait pas forcément
Un mot venu
au hasard se fait un sort infini, pousse des organes de
phrase, et la phrase en exige une autre, qui eût été avant
elle ; elle veut un passé qu’elle enfante pour naître…
Paul Valéry, Petite lettre sur les mythes
Avant Paris, il y
avait eu le Canada. Le Canada et ses neiges après les
moiteurs de Hong Kong, le Canada terre d’exil et de douleur
où elle avait débarqué à quinze ans en laissant derrière
elle les années dorées de l’enfance, les amitiés de
l’adolescence, et des souvenirs à n’en plus finir.
De Hong Kong …
et
la mer, au loin. Elle avait à peu près le même spectacle de
chez elle, et se levait parfois la nuit pour le contempler
un instant. Au printemps, des rouleaux de brume descendaient
des collines, comme dans un tableau de shanshui,
venaient noyer le paysage et le transformer en image
virtuelle, mouvante et insaisissable. On n’oublie pas ce
genre de chose.
Mais la vie passait
déjà par le cinéma. Les années 1960 furent celles de la
découverte de la Nouvelle Vague, au Phoenix Film Club, au
City Hall. C’était une période fantastique, pour le cinéma
français : Françoise Giroud venait d’inventer le terme de
Nouvelle Vague, les Quatre cents coups, Jules et Jim
déboulèrent sur les écrans de Hong Kong. Truffaut fut un
premier émerveillement. Il y eut aussi un Hiroshima en
anglais, mémorisé grâce aux sous-titres en chinois : la
Nouvelle Vague arrivait filtrée, mais fascinante,
dévoilée et expliquée par des esthètes passionnés de cinéma,
des jeunes encore étudiants,
… à Montréal
Le rêve de Paris
allait cependant abruptement prendre fin, ou du moins
devenir un songe aussi flou que la mer noyée dans la brume,
à Repulse Bay au printemps, lorsque la Révolution culturelle
déclenchée sur le continent fit ses ravages, comme par
ricochet, dans la cité coloniale : troubles et émeutes
téléguidés se multiplièrent en 1967, les Hongkongais prirent
peur, la rumeur enfla, on disait que la Chine allait tenter
un coup de force pour mettre la main sur le joyau de la
Couronne, tous ceux qui le purent partirent en masse, Hong
Kong se vida, le marché immobilier s’effondra : départ
précipité, la mère d’abord, le reste de la famille ensuite,
souvenir d’une cohue à l’aéroport, qui était encore celui de
Kai Tak, et d’une boucle d’oreille tombée dans la
bousculade, cadeau de départ inexorablement piétiné.
culture qui n’est
pas la sienne. Le rêve parisien devint rêve d’évasion,
nourri par les lectures, et surtout le cinéma, sur les
écrans du département des « communication arts » du Loyola
College.
Ces années
d’adolescence furent marquées par deux grands chocs
cinématographiques et esthétiques. Le premier fut « Mort à
Venise », de Visconti, nimbé d’une pureté éthérée des
sentiments et surtout du désir. Le second fut une
révélation déterminante :
« L’Arche »
(《董夫人》) de Tang Shu Shuen (唐书璇).
Film d’une extraordinaire beauté formelle sorti en 1969 à
Hong Kong, expression d’une subjectivité féminine complexe
et subtile, et d’une profonde alchimie entre la réalisatrice
et son actrice, il s’achève sur une note de sérénité trouvée
dans l’acceptation du sort qui eut un effet apaisant sur
Mary. Mais surtout, elle acquit la brusque certitude que sa
voie était désormais tracée : elle voulait se consacrer au
cinéma.
La fascination,
cependant, était difficile à partager dans un univers
d’exilés repliés sur leur communauté, tout entière tournée
vers l’effort d’intégration, pratique et matériel, qui ne
laissait pas de place au rêve. Le départ devint bouée de
sauvetage, et, cette fois-ci, fut longuement et
soigneusement préparé. Quand Mary obtint enfin la bourse
d’étude d’une année qu’elle avait demandée, ce fut une joie
fébrile : l’année concédée se mua dans son esprit en une
promesse de liberté infinie, et infiniment exaltante.
La liberté, il est
vrai, se révéla conditionnelle et conditionnée, soumise aux
aléas de l’obtention d’une carte de séjour et de moyens de
subsistance au quotidien, mais resta exaltante. Elle était
partie pour rencontrer Truffaut, Resnais ; ce fut Rohmer.
Mais, portées par son rêve personnel, tant d’autres choses
imprévues surgirent au détour du chemin, comme toujours…
3. Pour finir – ce
qu’il faut aussi savoir
Je
vis dans l’espace entre la vie et l’art
Rauschenberg
Il faut maintenant
reprendre la même histoire, mais sous un autre angle, non
l’angle rohmérien, mais l’angle personnel. Car si Mary avait
tellement rêvé de venir à Paris, c’est qu’elle avait un
projet de cinéma, qui fut bouleversé par sa découverte
d’ « India Song » dans un cinéma près de Maubert, et, à
travers ce film, de l’univers de Marguerite Duras.
Deux films
India Song, 1975,
un film qui imaginait Calcutta, tout en étant tourné en
partie au Bois de Boulogne, en partie à Versailles, en
partie dans deux appartements parisiens en ruines, un film
qui désynchronisait totalement le film des voix du film des
images, comme a dit Duras, et qui donnait une importance
primordiale à la musique, musique obsédante de D’Alessio,
mais aussi musique des voix, celle de Delphine Seyrig
répondant à celle de Lonsdale, et voix « intemporelles » de
Duras et autres…
Saint-Germain, pour peaufiner les dialogues, et surtout la
voix off, voix « intemporelle » comme chez Duras.
aussi présenté dans divers festivals, dont
le Festival de Carthage, sur recommandation de Pierre
Rissient,
interprète le rôle
de l’attaché d’ambassade dans India Song, et il l’avait
emmenée chez Marguerite Duras, une Duras à l’apogée de sa
création, qui venait de terminer « Son nom de Venise dans
Calcutta désert » et préparait « Aurelia Steiner ». La
fascination avait évidemment redoublé, tout en se
dédoublant.
Mathieu Carrière
devint l’un des acteurs de « Justocœur » : il y interprète
un psychiatre qui cherche à aider une danseuse partagée
entre deux personnages évanescents, ombres en costumes
blancs qui semblent, encore, sortir de chez Duras, ou de la
terrasse des Trois Magots, et dériver à la recherche
d’eux-mêmes, et d’une place à eux, quelque part. Monde
lacanien – « le rapport sexuel n’existe pas » -, mais pas
plus paisible pour autant, un monde en tension vers un
équilibre entre les corps.
« Justocœur » est
le reflet d’un talent bourgeonnant, coulé et moulé dans une
époque, le reflet, aussi, des rêves d’une jeune artiste en
apnée entre deux mondes, un orient et un occident qui n’ont
jamais très bien pu s’entendre. « Devant moi, il y a la
mer, » dit la voix de Marguerite Duras au début d’«
Aurelia Steiner », « entre le ciel et l’eau, il y a un
large trait noir, il couvre la totalité de l’horizon de la
régularité d’une rature géante, d’une différence
infranchissable… » Mary était au bord de la rature,
happée par un tourbillon de stimuli, de sensations, de
tentations, à s’y perdre.
Deux scénarios
Elle continua,
cependant, tout en poursuivant le travail d’apprentissage
chez Rohmer, qui suivait et guidait dans l’ombre – il
apparaît comme figurant dans « Justocœur », et c’est
lui qui a traduit et adapté les dialogues du scénario, que
Mary avait écrit en anglais. Mary écrivit un troisième
scénario, « Feux nocturnes », où elle imaginait une
famille anglaise à Paris dans les années 1900. Rencontrée au
hasard d’un week-end à Londres, Edith Cottrell la mit en
contact avec Jeanne Moreau qui, après avoir lu le scénario,
accepta de tenir le rôle principal – sa mère était anglaise,
c’était un rôle pour elle…
En association avec
John Cressey, Mary alla très loin dans le montage de la
coproduction, qui devait être franco-canadienne, mais ne
réussit pas à obtenir l’avance sur recettes ; le producteur
français était pourtant Alain Dahan, le producteur, entre
autres, de Chantal Akerman dans les années 1970. Tout partit
en fumée. Point à la ligne.
Elle repartit
pourtant illico sur la rédaction d’un autre scénario encore,
écrit avec l’aide de Rohmer, pour un film qui devait être
une comédie musicale, « After Giulio ». De la même
manière, avec John Cressey, elle mit en place la logistique,
avec une autre structure de coproduction,
franco-britannique. La partie française, cette fois, devait
être Humbert Balsan, qui venait de réaliser un documentaire
sur Nadia Boulanger, et qui allait soutenir nombre de jeunes
réalisatrices, de Claire Denis à Brigitte Roüan ou Sandrine
Veysset. On sent tout de suite les affinités.
Quant au producteur
britannique, il s’agissait de Gavrik Losey, le fils du
réalisateur Josey Losey. Là encore, pourtant, le film resta
à l’état d’ébauche, et le scénario rejoignit le précédent,
au fond du même tiroir… Epuisée, Mary jeta l’éponge. Elle
leva l’ancre et s’enfuit, en quête d’une autre amarre, dans
un autre port.
Elle
faillit reprendre son dernier projet, pourtant, des années
plus tard. Pour assurer le quotidien et celui de ses
enfants, elle travaillait au journal Vogue, comme assistante
de la rédactrice en chef, c’est-à-dire Colombe Pringle,
jusqu’en 1996. Or, son mari,
Jean-Pierre Mahot,
était l’associé de Balsan dans
sa société de production, Lyric International
– dont, par un de ces jeux de coïncidence qui donnent du sel
à toute histoire, les bureaux se trouvaient au-dessus
de ceux des Films du Losange de Rohmer.
Il
arrivait donc à Balsan de téléphoner au journal ; c’est
ainsi que Mary l’eut un jour au bout du fil, et eut la joie
de l’entendre dire qu’il continuait de s’intéresser à ce
qu’elle faisait et suivait sa carrière « de loin ».
Encouragée, Mary reprit donc l’écriture de son film, en
espérant secrètement que Balsan la guiderait dans son
projet.
La
nouvelle de son suicide, le 10 février 2005, fut un coup
très dur.
Elle prit sa voiture pour aller
se promener au bord des étangs de Ville-d’Avray, in
memoriam. Il faisait froid et les étangs étaient nappés dans
une légère brume, comme dans « Les dimanches de Ville
d’Avray », l’un de ces films mythiques qu’elle avait vus à
Hong Kong, autrefois. La nostalgie vint aviver encore sa
peine. Son ultime projet de film fut définitivement enterré.
Elle avait fait un
rêve, et crut l’avoir abandonné, mais tout rêve laisse sa
marque, comme celle d’un pas dans le sable humide, quand la
marée s’est retirée. Des années plus tard, la marque est
toujours là, les vagues successives en ont juste quelque peu
brouillé l’image. Mais elle jette un regard rétrospectif
pacifié sur ces matrices d’une œuvre qu’elle dit être le
« journal visuel d'une
jeunesse ».
Retour à l’écriture
et à l’image
être pas totalement faux. Après avoir travaillé trente
ans pour les autres, malgré quelques œuvres personnelles –
dont un documentaire sur le poète Breyten Breytenbach où
elle joue subtilement sur les sonorités du néerlandais, de
l’afrikaans et du chinois, car figurent en contrepoint des
poèmes de Breytenbach traduits et lus par Bei Dao - elle a
amorcé un retour sur elle-même, une sorte de retour aux
origines, sachant que tout retour ne se fait jamais
exactement au point de départ, la vie s’est chargée en cours
de route de brouiller les pistes.
Après avoir fait le
deuil de sa langue, celle de son enfance et celle de sa
mère, elle s’en est choisi et approprié une autre : ni le
chinois ni le français, mais la lingua franca des
temps modernes et des nouveaux nomades, l’anglais, souple et
modulable à loisir. Mais la langue reste quand même associée
chez elle à l’image, une image, cependant, qu’elle
n’envisage que sous un aspect très personnel, expérimental…
Qui reste à
concrétiser, et qu’il restera à découvrir….
Filmographie
sélective
- Films chinois
montés par Mary Stephen (Chine continentale et Hong Kong)
Fiction
2007 Blind
Mountain (《盲山》)
de
Li Yang (李杨)
2008 Life is
Easy (《惬意的生活》)
de Wen Wu (文武)
2010 The
Drunkard (《酒徒》)
de Freddie Wong (黃國兆)
Documentaires
- De
Du Haibin (杜海滨) :
2007 Parapluies (《伞…》)
2013 Patriotisme
(en cours)
- Autres :
2009 Last Train
Home (《归途列车》),
de Fan Lixin (範立欣)
2011 Datong : Kang
Yuwei in Sweden (《大同:康有為在瑞典》)
de Evans Chan (陳耀成)
2013 Flowing
Stories (河上變村)de
Jessey Tsang Tsui Shan (曾翠珊)
(en cours)
- Documentaires
étrangers sur la Chine
2001 Hong Kong
Cinema, de Hubert Niogret, France
2013 China Me, de
Michka Saäl, Chine-France-Canada
2013 China, The New
Empire, de Jean-Michel Carré, ARTE, France
|














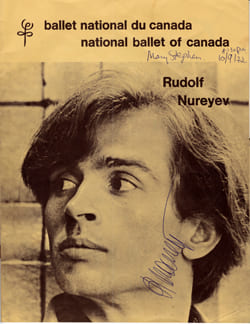






No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.